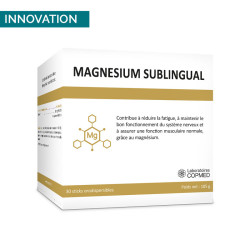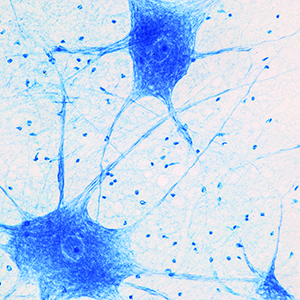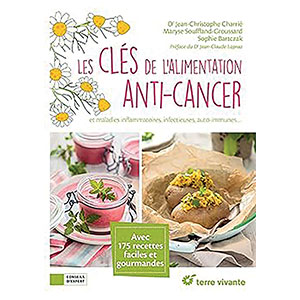La France a été un leader en médecine avec des penseurs comme Claude Bernard, mais nous sommes aujourd’hui dans une phase de régression. Notre système médical manque de souplesse et d’ouverture. Nous avons perdu l’attention aux sciences humaines – anthropologie, sociologie, psychologie – qui sont pourtant essentielles pour comprendre les patients dans leur globalité. J’ai pris juste avant l’exemple du Mexique, parce que j’y ai appris énormément de choses. Là-bas, la quasi-totalité des médecins est avant tout anthropologue. C’est une société multiculturelle.
Historiquement, il faut se rappeler que le Mexique a été sous la dépendance française pendant 3 années sous Napoléon III. En partant, il a abandonné tout son corps d’armée sur place. De nombreux Français ont fait souche là-bas, à tel point que dans l'amphithéâtre que j’avais lorsque je donnais cours, j’ai compris que 80 % des médecins que j’avais en face de moi avaient un grand-père ou un arrière-grand-père français. Il y a donc une véritable culture française au Mexique.
Chez les bouquinistes, les livres médicaux sont en français, tout comme ce qui est exposé dans les musées de médecine. Le courant de la pensée de la médecine française Claude Bernard a inondé le Mexique. J’ai appris grâce aux Mexicains, que l’endobiogénie est la suite et peut être le dernier souffle de la pensée de Claude Bernard.
L’endobiogénie n'aurait en quelque sorte pas pu naître ailleurs qu’en France. C’est un de nos maîtres fondamentaux qui a conceptualisé l’homéostasie, qui est la base de réflexion de l’endobiogénie. Cette culture est là mais est devenue subliminale.
Aujourd’hui la culture médicale actuelle dans le monde est anglo-saxonne, nourrie par Pasteur. Un Français, certes, mais qui a nourri le courant de pensée anglo-saxon. Pasteur n’était pas médecin, c’était un physicien. Pour un physicien c’est souvent « blanc ou noir », pour un biologiste c’est gris clair ou gris foncé, car la vie nous réserve parfois quelques surprises qui font qu’on ne maîtrise pas tout. Il y a une grande différence de conceptualisation. En dépit de notre histoire coloniale, en France, nous n’avons pas dans l’enseignement médical de culture anthropologique contrairement au monde Hispanique. C’est une grande faiblesse de notre système actuel, d’oublier les sciences humaines dans la médecine. À mon sens, cela manque vraiment.
Cela dit, je reste optimiste. D’une part, parce qu’on s’est aperçu que dans nos promotions, on est souvent en présence de médecins d'âges différents, désireux de poursuivre leur apprentissage, pour pouvoir transmettre à leur tour leurs connaissances.
D’autre part, parce que les jeunes générations de médecins montrent un intérêt grandissant pour des approches intégratives et préventives. Avec l’Institut, nous travaillons à leur transmettre ces outils pour qu’ils puissent, à leur tour, transformer la pratique médicale.