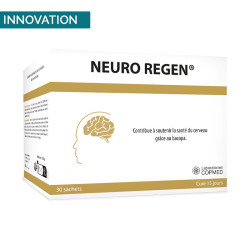Le cerveau humain, bien qu’il ne représente qu’environ 2 % du poids corporel total, consomme à lui seul 20 à 25 % de l’énergie métabolique disponible chez un adulte au repos.
Cette exigence énergétique exceptionnelle témoigne de la densité des processus électrochimiques qu’il coordonne en permanence : transmission synaptique, modulation de l’influx nerveux, recyclage des neurotransmetteurs, plasticité et neurogenèse.
Sur le plan histologique, le tissu cérébral est constitué de deux grandes familles cellulaires :
les neurones, qui assurent la communication rapide via des potentiels d’action, et les cellules gliales, qui structurent, régulent, protègent et coordonnent l’activité neuronale. Parmi celles-ci, les astrocytes jouent un rôle central dans l’homéostasie ionique et métabolique, les oligodendrocytes produisent la myéline facilitant la conduction de l’influx nerveux, et les microglies remplissent des fonctions immunitaires essentielles.
La barrière hématoencéphalique (BHE) représente une interface protectrice de très haute spécialisation. Elle empêche le passage non contrôlé de substances potentiellement neurotoxiques et assure une filtration moléculaire stricte.
Toute altération de cette barrière, qu’elle soit inflammatoire, métabolique ou vasculaire, est aujourd’hui reconnue comme facteur aggravant de pathologies neurologiques telles que les maladies d’Alzheimer, de Parkinson ou la sclérose en plaques (Sweeney et al., 2019).
Cerveau et conscience : un grand dilemme !
À partir de ces structures biologiques se déploie un processus fondamental : le champ électromagnétique cérébral.
Produit par les mouvements ioniques à travers les membranes neuronales, ce champ peut être enregistré par l’électroencéphalographie (EEG) et la magnétoencéphalographie (MEG).
Ces oscillations sont synchronisées par la structure des réseaux neuronaux et leur rythme est associé à différents états de conscience (veille, sommeil, transe, méditation).
Cependant, et c’est un point fondamental, les corrélats neuronaux de la conscience (CNC), même s’ils sont mesurables et modélisables, ne constituent pas une preuve de la genèse de la conscience par le cerveau lui-même.
Ils n’en sont que les marqueurs périphériques. Cette distinction est au cœur des débats en neurophilosophie, notamment entre théories matérialistes et modèles étendus de la conscience (Chalmers, 1995).
En d’autres termes, observer l’activation synchrone de certaines zones cérébrales au moment d’un souvenir ou d’une émotion n’implique pas que ce souvenir ou cette émotion soit « créé » dans cette structure.
Le cerveau agirait plutôt comme un récepteur régulateur que comme un générateur de conscience.