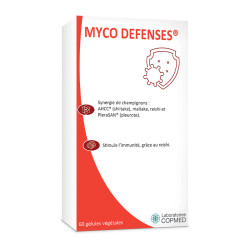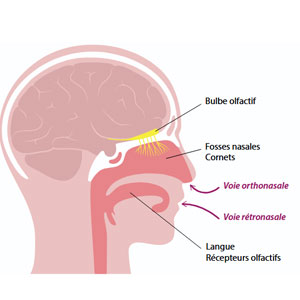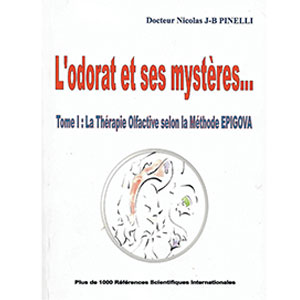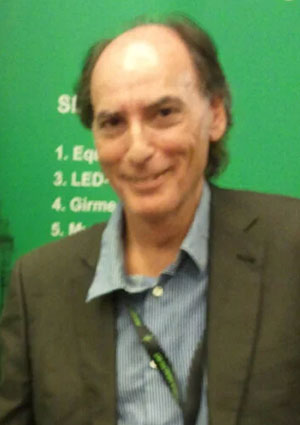Sources :
(1) Magoun Harold I, L’ostéopathie dans la sphère crânienne, traduit par Julie Saint-Pierre et Philippe Druelle, éditions Spirales, 1994, collection Tradition et recherche en ostéopathie, 368 p.
(2) Hummel T, Liu DT, Müller CA, Stuck BA, Welge-Lüssen A, Hähner A. Olfactory Dysfunction: Etiology, Diagnosis, and Treatment. Dtsch Arztebl Int. 2023 Mar 13;120(9):146-154. DOI : 10.3238/arztebl.m2022.0411. PMID: 36647581; PMCID: PMC10198165.
(3) Pinto JM, Wroblewski KE, Kern DW, Schumm LP, McClintock MK (2014) Olfactory Dysfunction Predicts 5-Year Mortality in Older Adults. PLoS ONE 9(10): e107541. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0107541.
(4) (a) Bonfils P., Faulcon P., Tavernier L., Bonfils N. A., Malvinvaud D. Home accidents associated with anosmia. Presse Med. 2008 May;37(5 Pt 1):742-5. DOI : 10.1016/j.lpm.2007.09.028. Epub 2008 Mar 10. French. PMID: 18329839. Accidents domestiques chez 57 patients ayant une perte sévère de l’odorat, La Presse Médicale, Volume 37, Issue 5, Part 1, 2008, pp 742-745, ISSN 0755-4982, https://doi.org/10.1016/j.lpm.2007.09.028
(b) Landis B.N., Lacroix J.-S. Pathologie de l’odorat. Traité d’ORL. Flammarion, 2008. ISBN: 978-2-2570-0005-7.
(c) Santos DV, Reiter ER, DiNardo LJ, Costanzo RM. Événements dangereux associés à une altération de la fonction olfactive. Arc oto-laryngol Tête Neck Surg. 2004 Mar ; 130(3):317-9. DOI : 10.1001/archotol.130.3.317. PMID : 15023839.
(5) Pinelli, 2017 (a) (b), 2018 (c), 2023 (d), 2024 (d)
(a) Pinelli N. J-B. , Évaluation des marqueurs olfactifs, représentation en une, deux, trois dimensions d’une typologie olfactive et d’une dysosmie, INPI, Brevet n° FR1771222 – déposé le16/11/2017.
(b) Michel, F-B., Pinelli, N. J-B., Maladie d’Alzheimer : un nouveau test et une piste de traitement, Psychiatrie, Sciences humaines, Neurosciences, vol. 15, no. 4, 2017, 39-49.
(c) Pinelli, N. J-B., La rééducation olfactive : une nouvelle méthode pour les kinésithérapeutes. Actu’Alizé N°48 – 03/2018 26-31.
(d) Pinelli N. J-B., Une nouvelle thérapie olfactive pour les maladies neurodégénératives, doctorat naturopathie, Collège supérieur de naturopathie du Québec, Canada, 2023, 94 p.
(e) Nicolas J-B Pinelli L’odorat et ses mystères… Tome 1 : La thérapie olfactive selon la méthode EPIGOVA, Éditions Ermengaud, 1re Ed, déc. 2024, 404 p., ISBN 978-2-955-9445-16
(6) Damm M, Schmitl L, Müller CA, Welge-Lüssen A, Hummel T. Diagnostik und Therapie von Riechstörungen [Diagnostic et traitement de la dysfonction olfactive]. HNO. avril 2019 ; 67(4):274-281. Allemand. DOI : 10.1007/S00106-019-0614-X. PMID : 30725125.